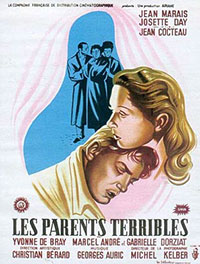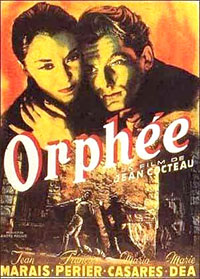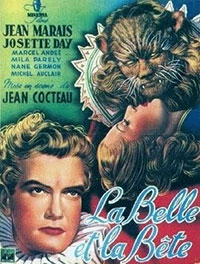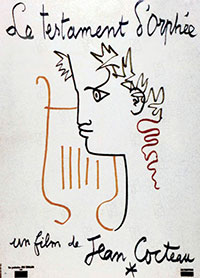DVD1 : Les chevaux de feu. DVD 2 : Sayat Nova. DVD 3 : La Légende de la forteresse de Souram. DVD 4 : Achik Kérib, conte d’un poète amoureux. 30 €.
Nombreux suppléments.
Restoration
In 2014 the film was digitally restored and re-edited to be as close as possible to the director’s original vision and world premiered at the 67th Cannes Film Festival.[22][23] The US premiere took place on 20 September 2014 at The Academy at Los Angeles County Museum of Art (LACMA) and was introduced by Martiros Vartanov. The East Coast premiere took place at the 52nd New York Film Festival on 2 October 2014, and was introduced by Scorsese. The restoration was completed by Martin Scorsese's Film Foundation in conjunction with Cineteca di Bologna, and was, described by critic and Toronto festival programmer James Quandt as "a cinematic Holy Grail".[3] Martin Scorsese received the 2014 Parajanov-Vartanov Institute Award for the restoration of The Color of Pomegranates.[5]
A Blu-ray of the restoration was released in the UK on 19 February 2018, and an American release by Criterion with Mikhail Vartanov's 1969 documentary The Color of Armenian Land on 17 April 2018.
Sayat Nova (film) / Sergueï Paradjanov
La Couleur de la
grenade
Sayat Nova (en français : La Couleur de la grenade / Tsvet granata)
est un film soviétique réalisé par Sergueï Paradjanov. Distribué une première
fois en 1969, le film est retiré des écrans puis, à nouveau, diffusé dans une
version remontée et abrégée par le réalisateur Serguei Youtkevitch, sous le
titre La Couleur de la grenade en 1971.
La vie de Sayat-Nova, poète arménien du xviiie siècle, en huit
chapitres :
I : L'enfance du poète.
II : La jeunesse du poète.
III : Le poète à la cour du prince/Prière avant la chasse.
IV : Le poète se retire au monastère/Le sacrifice/La mort du
katholikos.
V : Le songe du poète/Le poète retourne à son enfance et pleure la
mort de ses parents.
VI : La vieillesse du poète/Il quitte le monastère.
VII : Rencontre avec l'Ange de la Résurrection/Le poète enterre son
amour.
VIII : La mort du poète/Il meurt mais sa poésie est immortelle.
En ouverture du film, un carton précise les intentions de Paradjanov :
« Aimable public, ne va pas chercher dans ce film la vie de Sayat-Nova, grand
poète arménien du xviiie siècle. Nous n'avons que tenté de rendre par les
moyens du cinéma l'univers imagé de cette poésie dont le chantre russe Valéri
Brioussov disait : “La poésie arménienne du Moyen Âge est une des éclatantes
victoires de l'esprit humain inscrites dans les annales de notre monde.” »
Fiche technique
Titre original : Sayat Nova
Titre alternatif : La Couleur de la grenade (Tsvet granata)
Réalisation et scénario : Sergueï Paradjanov
Photographie : Souren Chakhbazian - 35 mm/Couleurs
Son : Iouri Sayadian
Musique : Tigran Mansourian
Décors : Stepan Andranikian
Costumes : E. Akhvlediani, I. Karalian, J. Sarabian
Maquillage : A. Astchian, V. Assatrian
Production : Armenfilm
Directeur de production : A. Mélik-Sarkissian
Durée : 73 minutes (dans la version remontée par Serguei Youtkevitch)
Pays d'origine : Drapeau de l'URSS Union soviétique/Drapeau de
l'Arménie Arménie
Sortie : 1969
Sortie en France : 13/01/1982
Distribution
Sofiko Tchiaoureli : le poète jeune/la bien-aimée du poète/la nonne
aux dentelles blanches/l'Ange de la Résurrection/ le mime
Melqon Alekian : le poète enfant
Vilen Galestian : le poète au couvent
Gueorgui Gueguetchkori : le poète vieux
Hovhannes Minassian : le roi Irakli
Tournage
Tourné du 17 août 1967 au 22 juillet 1968 aux Studios Armenfilm à
Erevan (la séquence des teinturiers ou le colloque entre le poète et la
princesse Anna, par exemple) et en décors naturels : les scènes de l'enfance du
poète au monastère de Haghpat ; d'autres scènes en Géorgie et en Azerbaïdjan.
L'épisode des bains fut tourné en studio à Kiev.
Il existe deux versions du film : l'une, distribuée en République
soviétique d'Arménie, d'une durée de 78 minutes, estimée comme plus proche de
la version souhaitée par Sergueï Paradjanov, désormais disponible en DVD ; la
seconde, remontée par Youtkevitch, d'une durée de 73 minutes, distribuée à
l'étranger à partir de 1977.
Commentaire
Avec Sayat Nova, le spectateur découvre une expérience unique. «
L'envoûtement, l'hypnose même créés par ce poème visuel, procession de tableaux
somptueux », s'expliquent, certes, par de multiples facteurs, mais d'abord par
l'« utilisation différente de l'espace filmé, réduisant considérablement la
profondeur de champ. En utilisant son cadre comme un miniaturiste, Sergueï
Paradjanov lui accorde un crédit inhabituel. Les à-plats renforcent la
symbolique des objets, accentuent leur baroque », écrit Patrick Cazals1.
« Le film ressemble à un album mécanique d'images. À cet égard, la
scène des grimoires sur les toits du monastère est fortement emblématique. Il
s'agit bien pour le cinéaste d'offrir une manière de renaissance aux miniatures
qui illustrent ces volumes », écrit, pour sa part, Érik Bullot2.
Ainsi, bien que le film soit quasiment muet (« La peinture est muette,
mes films aussi », dit Paradjanov), il s'ordonne « selon une métrique
rigoureuse, une alchimie et une musique interne qui nourrissent chaque
allégorie ou composition d'une tension extrême. »3[réf. non conforme]
« Véritable labyrinthe de signes, d'objets et symboles », liés à la
culture arménienne, le film n'est-il, pourtant, qu'offrande à la patrie aimée ?
« Reprenant le message de paix et de fraternité que lançait le poète
Sayat-Nova, écrivant ses œuvres dans les trois langues (arménien, géorgien,
azéri), (...) la destinée du film rejoint celle de milliers d'exilés et de
reclus et anticipe étrangement sur le sort du réalisateur brisé dans sa
création. »3
En février 2015, le compositeur Nicolas Jaar publie sur internet une
version du film dont il a composé la musique4.
"Excepté le langage cinématographique suggéré par Griffith et
Eisenstein, le cinéma mondial n’a probablement rien découvert de nouveau d’une
façon révolutionnaire depuis Couleur de grenade". Mikhail Vartanov5
Sayat Nova décrit par une personnalité intellectuelle d'origine
arménienne
« (...) Pour évoquer les épisodes de la vie et même les pensées et les
poèmes de Sayat-Nova, Sergueï Paradjanov utilise “le langage conventionnel mais
extrêmement précis des objets”. Ces objets somptueux ou humbles, ce sont des
tapis, des vêtements, des étoffes, des ornements, des vases, des instruments de
musique, des ustensiles, témoins concrets de la vie des hommes du passé,
produits de leur travail et outils de leur travail : avec une passion
d'ethnographe, une ferveur d'esthète, Paradjanov se lance avec ses amis à leur
découverte. Il obtient du Catholicos Vazguen Ier les manuscrits d'Etchmiadzin
qu'il fait palpiter sur les toits du monastère de Haghbat. Il arrache aux
conservateurs de musées l'autorisation de sortir de leur vitrine tapis,
costumes et vases. Et dans sa passion pour les chevaux de race, il amène même
l'armée soviétique à lui prêter ses alezans. »6[réf. non conforme]
De fait, « Sayat Nova peut se feuilleter comme un livre d'images,
surgies de la mémoire collective arménienne. Le rythme statique et la
frontalité de la composition, l'écran divisé en plans verticaux et horizontaux,
l'éclat des couleurs, ces mouvements comme suspendus, ces yeux immenses où
affleure l'âme des acteurs, renvoient aux enluminures et aux fresques des
églises arméniennes, rappellent les hauts-reliefs du monastère d'Aghtamar dont
les saints et les anges, aux paumes larges ouvertes, vous suivent de leur
regard de pierre. »
=========================
Sergueï Paradjanov
Sergueï Iossifovitch Paradjanov (en cyrillique russe : Сергей
Иосифович Параджанов ; en arménien : Սարգիս Հովսեպի Պարաջանյան, Sarkis
Paradjanian), né le 9 janvier 1924 à Tbilissi en République socialiste fédérative
soviétique de Transcaucasie, mort le 20 juillet 1990 à Erevan en RSS d'Arménie,
est un réalisateur soviétique1.
Il fut controversé en Union soviétique (astreint en 1973 aux travaux
forcés pendant quatre ans, puis incarcéré à différentes reprises jusqu'en
1982), mais très défendu et apprécié par les cinéphiles occidentaux2. Un musée
lui est consacré à Erevan, en Arménie, où il est considéré comme le grand
cinéaste national.
Biographie
Sans connaître la langue de ses ancêtres arméniens, ni leur pays,
Paradjanov va graduellement s’éloigner de la grammaire soviétique pour élaborer
une œuvre cinématographique en prise directe avec les traditions des régions où
il tourne (Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie). Artiste pluriethnique,
musicien, plasticien, peintre, il doit en partie sa tournure d’esprit au fait
que son père, Iossif Paradjanian, était antiquaire. Un contact précoce avec les
objets d’art a façonné son imaginaire et son goût pour les collections. Il a
inspiré sa pratique passionnée des collages, qui tiennent à la fois de l’art
conceptuel et du folklore naïf ; des films compressés en quelque sorte, que
Paradjanov bricolait lorsqu’il ne pouvait pas tourner (en prison notamment). Sa
vie et son art étaient mêlés. Sa maison familiale de Tbilissi, ouverte aux
hôtes de passage, était un grand capharnaüm où s’entassaient décors, costumes
et objets d’art hétéroclites.
Paradjanov est issu de l’une des plus grandes écoles de cinéma du
monde, le VGIK de Moscou, dans laquelle il entre en 1945 et où il étudie dans
la classe d'Igor Savtchenko3. Un de ses professeurs est Alexandre Dovjenko.
En 1954, il réalise son premier long métrage Andriesh, adapté du conte
d'Emilian Radu Bucov4. Paradjanov émigre ensuite à Kiev où il tourne plusieurs
documentaires (Doumka, Les Mains d'or, Natalia Oujvy).
En 1964 et 1968, Paradjanov réalise deux des chefs-d'œuvre
cinématographiques du xxe siècle : Les Chevaux de feu et Sayat-Nova.
Musée Sergueï Paradjanov à Erevan.
Vie privée
En 1950, Paradjanov se marie avec Nigyar Kerimova, à Moscou. D'origine
musulmane tatare, elle se convertit à la religion orthodoxe pour l'épouser.
Elle sera plus tard assassinée par des parents qui ne lui ont pas pardonné
cette conversion. Lorsqu'il s'installe à Kiev, il apprend l'ukrainien et se
remarie avec Svetlana Ivanovna Cherbatiouk en 1956. Elle lui donnera un fils
(Suren, 1958).
Filmographie commentée et censure soviétique
Les Chevaux de feu
Les Chevaux de feu (Тіні забутих предків) est réalisé en 19645. C'est
la version courte des Ombres des ancêtres oubliés. Tiré de l’œuvre de Mikhaïl
Kotzioubinski, ce conte met en scène des bergers et bûcherons des Carpates
ukrainiennes. Douze chapitres retracent la vie tragique d'Ivan, paysan accablé
par le destin, mis au ban de sa communauté6,7. En 1991, on attribue à
Paradjanov le prix national Taras Chevtchenko pour ce film à titre posthume.
Sayat-Nova
En 1968, il réalise Sayat Nova8. Le film sera également censuré. Sayat
Nova (La Couleur de la grenade), est inspiré de la vie d’un poète arménien mort
en Géorgie. Au lieu d’un récit linéaire, le cinéaste, à la fois structuraliste
et traditionaliste, opte pour une série de tableaux vivants représentant des
moments clés de la vie du poète. Paradjanov déclare : « Il m’a semblé qu’une
image statique, au cinéma, peut avoir une profondeur, telle une miniature, une
plastique, une dynamique internes… »
« Immense mulquinier (ou tisserand) d'images, comme Sarkis Paradjanian
(dit Sergueï Paradjanov) a été bateleur d'images. Son film allégorique,
demeurera comme une vraie clef pour la compréhension de l'œuvre du troubadour.
Tous deux parlent autrement, par figures, et c'est là, toute la force de leur
création temporelle sur l'agora de leur temps et de tous les temps », selon les
traducteurs français9.
Monument à Sergueï Paradjanov à Tbilissi.
Ses films singuliers sont souvent influencés par la diversité ethnique
de sa région natale, le Caucase, et mêlent réalité sociale, folklore, légendes
et chamanisme. Ses premières œuvres, tournées en Ukraine (et inédites et
France), sont assez proches du réalisme socialiste (comme Le Premier gars,
amourettes champêtres dans un kolkhoze) jusqu'à la rupture des Chevaux de feu
en 1965. Découvert dans les festivals internationaux avec ce film, Paradjanov
sera pour l’Occident le premier symbole officiel de l’oppression des artistes
soviétiques (Tarkovski en sera un autre)10.
Victime de la censure soviétique
Ce chef-d’œuvre est désavoué par les autorités de Moscou parce qu’il
est tourné en dialecte houtsoul (des Carpates ukrainiennes) et non doublé en
russe. C'est une des raisons pour lesquelles, certains historiens du cinéma le
considéreront comme un exemple de cinéma ukrainien. Il est également désavoué
par le cinéaste lui-même parce qu’on l’a raccourci contre son gré, mais aussi
parce qu’il ne correspond pas au cinéma non narratif auquel il aspire.
Si cet artiste hors catégorie jouit alors d’une certaine notoriété,
c'est moins pour son œuvre que pour son statut politique. En décembre 1973, les
autorités soviétiques le condamnent à cinq ans de travaux forcés. Paradjanov
fait la une des journaux lorsqu’il est incarcéré en Ukraine en 1974 pour «
commerce illicite d’objets d’art, homosexualité et agression sur la personne
d’un fils de dignitaire du régime », les médias, les comités se mobilisent (en
France, Yves Saint Laurent, Françoise Sagan, et surtout Louis Aragon, montent
au créneau). Le pouvoir reproche implicitement au cinéaste de promouvoir le
nationalisme. À l’époque, il a déjà tourné l’essentiel de son œuvre : six longs
métrages. Il est incarcéré pendant quatre ans.
Au sortir de sa détention, il réalise des collages et produit un grand
nombre de dessins abstraits. Mais il sera à nouveau incarcéré. Ses divers
séjours en prison s’achèvent en 1982. Il en revient malade (diabétique,
cancéreux). Mais soutenu par plusieurs intellectuels géorgiens, il réussit à
tourner deux films.
La Légende de la forteresse de Souram (1985)
Le film est tiré d’une nouvelle du Géorgien Daniel Chonkadzé selon
laquelle une forteresse ne peut être sauvée de la ruine que si un homme y est
emmuré. Le film est tourné en plans larges fixes et frontaux.
Achik Kérib (1988) ou le conte d'un poète amoureux
Article détaillé : Achik Kérib, conte d'un poète amoureux.
Le film s'inspire d’une nouvelle du poète russe Mikhaïl Lermontov,
rappelle les contes des Mille et une nuits : un jeune troubadour pauvre tombe
amoureux de la jolie fille d'un riche marchand. Pour pouvoir l’épouser il
décide de faire fortune en parcourant le monde... Paradjanov dédiera ce film à
son grand ami le cinéaste Andreï Tarkovski.
Pour Paradjanov, l’essentiel n’était pas la narration, mais la vision,
l’image. En effet, il s'agit comme chez Pier Paolo Pasolini d'un cinéma de
poésie selon la formule de Pasolini lui-même. En cela Paradjanov demeure
influencé par le cinéma de Pasolini. Il disait s’inspirer souvent de ses rêves
et ne faisait pas de distinction entre un tableau et un film. Il avait à peine
commencé le tournage de La Confession, une allégorie ouvertement politique et
polémique, quand il meurt d'un cancer à l'âge de 66 ans. Les quelques plans
qu'il a réussi à tourner seront inclus dans le film Paradjanov : Le Dernier
Printemps, réalisé par son proche ami Mikhaïl Vartanov en 1992.
Filmographie
Courts métrages
1951 : Conte moldave (Moldovskaya skazka) (film de fin d'études,
considéré comme perdu)
1957 : Dumka (documentaire)
1959 : Natalya Ushvij (Natalia Uzhvij) (documentaire)
1960 : Les Mains d'or (Zolotye ruki) (documentaire)
1966 : Les Fresques de Kiev (inachevé, interdiction de tournage)
1967 : Hakob Hovnatanian (Hakob Havnatanyan) (documentaire)
1968 : Les Enfants à Komitas (Yerekhaner Komitasin) (documentaire pour
l'UNICEF, considéré comme perdu)
1985 : Arabesques sur le thème de Pirosmani (Arabeskebi Pirosmanis
temaze) (documentaire)
Longs métrages
1954 : Andriesh (coréalisé avec Yakov Bazelyan)
1959 : Le Premier Gars (Pervyj paren)
1961 : Rhapsodie ukrainienne (Ukrainskaya rapsodiya)
1962 : Une fleur sur la pierre (Tsvetok na kamne)
1964 : Les Chevaux de feu (Tini zabutykh predkiv)
1968 : Sayat Nova (La Couleur de la grenade/Tsvet granata)
1984 : La Légende de la forteresse de Souram (Ambavi Suramis
tsikhitsa) (coréalisé avec Dodo Abachidze)
1988 : Achik Kérib, conte d'un poète amoureux (Ashugi Qaribi)
(coréalisé avec Dodo Abachidze)
1992 : La Confession (Khostovanank)
(inachevé)
Sayat-Nova
Sayat-Nova (en arménien Սայաթ-Նովա, en persan سایات نووا, en géorgien
საიათ-ნოვა)
(14 juin 1712 à Tiflis – 22 septembre 1795 à Haghpat), ou le « roi des chansons
», est le nom donné au poète arménien Harutyun Sayatyan, ou le nouveau Saâdi.
Biographie
Sayat-Nova naquit le 14 juin 1712 à Tiflis, aujourd'hui en Géorgie. Il
fut barde1, un ashik célébré autant que honni à la cour d'Irakli II (ou
Héraclius II de Géorgie). Irakli II aurait aidé à créer une alliance entre la
Géorgie, l'Arménie et le Shirvan contre l'Empire perse.
Banni de la cour par le roi en 1759, Sayat-Nova devint par sentence
royale moine au monastère de Haghpat, parce qu'il serait, semble-t-il, tombé
amoureux de sa sœur, la princesse Anna Batonachvili. Il est assassiné par
l'armée d'Agha Mohammed Khan qui dévasta la ville de Tiflis et ses alentours,
en 1795.
Style
Chanteur et maître du kamânche, Sayat-Nova joue, compose avec son
instrument préféré, il écrit de la poésie, soit 68 odes en arménien, 65 odes en
géorgien et 128 odes en dialecte turc de la Transcaucasie. Ce qui le
caractérise, c'est sa « singularité universelle ». Selon Élisabeth Mouradian et
Serge Venturini, traducteurs du poète en France, « trois siècles après son
œuvre, celui qui écrivit en plusieurs langues demeure toujours un pont entre
les peuples du Caucase, où il est toujours chanté et aimé de tous. »
Postérité
Monument à Sayat-Nova, Erevan.
Son influence fut profonde sur tous les poètes arméniens les plus
éminents, ainsi que sur d'autres poètes européens et russes à partir de 19162.
Le poète Archag Tchobanian écrivit ces lignes dans son Ode à la langue
arménienne : « Un printemps nouveau resplendit, purifia tes eaux, leur donna
une transparence de cristal et un éclat de perle ; une brise aux ailes légères
rafraîchit ton sein ; une clarté mauvaise fit pleuvoir sur toi des roses et des
lys ; sur tes rives des vignes s'épanouirent, et des rossignols vinrent, cachés
dans leurs ombres amies, moduler leurs tendres chansons ; c'était l'essaim
mélodieux des Trouvères3... ».
En 2012, la ville d'Erevan, capitale de l'Arménie, nommée « Capitale
mondiale du livre 2012 » par l'UNESCO4 fête le tricentenaire de la naissance du
troubadour.
Cinéma
Sergueï Paradjanov réalisa (1968), d'après la vie du poète, un des
chefs-d'œuvre cinématographiques du xxe siècle5 : Sayat-Nova (La Couleur de la
Grenade). Musique : Tigran Mansourian.
Œuvres
(fr) (hy) Sayat-Nova (trad. Élisabeth Mouradian et Serge Venturini),
Odes arméniennes, édition bilingue, L'Harmattan, 2006, (ISBN 2-296-01398-8).
==========================================
|