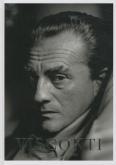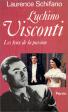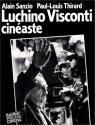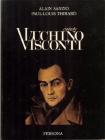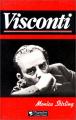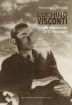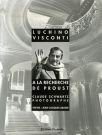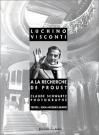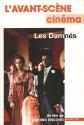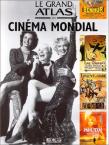Luchino Visconti (1906-1976)
Luchino Visconti di Modrone, comte de Lonate Pozzolo (n. 2 noiembrie1906, Milan – d. 17 martie 1976, Rome), fiul ducelui Giuseppe Visconti di Modrone, descendent din familia ducilor Visconti din Milano, care au stapanit ducatul Milano intre 1277- 1447.
===============================================
LUCHINO VISCONTI
Naissance : 2 novembre 1906
Décès : 17 mars 1976
Pays : Italie
Métiers : réalisateur, scénariste
 | ||
(1906 - 1976)
| ||
| 13 films | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
Selon Gilles Deleuze, le génie de Visconti culmine dans ces grandes scènes, souvent en rouge et or, que sont l'opéra de Senso, le bal du Guépard, le château de Munich de Ludwig, les salles du grand Hôtel de Mort à Venise, ou le salon de musique de L'innocent. Ce sont les images cristallines d'un monde en décomposition.
Deleuze distingue en effet quatre éléments fondamentaux dans le cinéma de Visconti :
1 - Le monde aristocratique des riches : c'est lui qui est cristallin, mais on dirait un cristal synthétique, parce qu'il est hors de l'histoire et de la nature. L'abbé du Guépard l'expliquera : nous ne comprenons pas les riches, parce qu'ils ont créé un monde à eux, dont nous ne pouvons saisir les lois, et où ce qui nous parait secondaire ou même inopportun prend une urgence, une importance extraordinaires. Ce monde n'est pas celui de l'artiste créateur, bien que Mort à Venise mette en scène un musicien, mais justement dont l'oeuvre est trop intellectuelle, cérébrale. Ils se réclament de la liberté, mais d'une liberté dont ils ont la jouissance comme un privilège vide qui leur viendrait d'ailleurs, des aïeux dont ils descendent et de l'art dont ils s'entourent.
2 - Dans ce cristal s'accomplit un processus de décomposition qui le mine du dedans, l'assombrit, l'opacifie. Pourrissement des dents de Louis II, abjection de l'amour de la comtesse dans Senso, partout la soif de meurtre et de suicide, ou le besoin d'oubli et de mort, comme dit le vieux prince pour toute la Sicile.
3 - L'Histoire double la décomposition, l'accélère et l'explique : les guerres, la prise de pouvoir de nouvelles puissances, la montés de nouveaux riches qui ne se proposent pas de pénétrer les lois secrètes du vieux monde, mais de le faire disparaître. L'Histoire ne se confond pas avec la décomposition interne du cristal, c'est un facteur autonome auquel Visconti tantôt consacre des images, tantôt splendides tantôt donne une présence d'autant plus intense qu'elle est elliptique. Dans Ludwig, on verra très peu d'histoire, Louis II veut tout en ignorer l'histoire gronde à la porte. Dans Senso au contraire elle est là, avec le mouvement italien. Mais présente ou hors champ, l'Histoire n'est jamais décor. Elle est saisie de biais, dans une perspective rasante, sous un rayon levant ou couchant, une sorte de laser qui vient couper le cristal sous une pression d'autant plus puissante qu'elle est extérieure comme le choléra à Venise ou l'arrivée silencieuse des SS à l'aube.
4 - Le quatrième élément, c'est la révélation que quelque chose vient trop tard. Pris à temps cela aurait pu peut être éviter la décomposition naturelle et la désagrégation historique de l'image-cristal. Mais c'est l'histoire et la Nature elle même, la structure du cristal, qui font que cela ne peut venir à temps. Déjà dans Senso, "trop tard, trop tard" hurlait l'abject amant, trop tard en fonction de l'Histoire qui nous divise, mais aussi de notre nature aussi pourrie chez toi que chez moi. Le prince, dans Le guépard, entend le trop tard qui s'étend sur toute la Sicile. Ce quelque chose qui vient trop tard, c'est la révélation sensible et sensuelle d'une unité de la Nature et de l'Homme. Le vieux prince ayant approuvé le mariage d'amour entre son neveu et la fille du nouveau riche reçoit, dans une danse, la révélation de la fille : leurs regards s'épousent, ils sont l'un pour l'autre, tandis que le neveu est repoussé au fond, lui-même annulé et fasciné par la grandeur de ce couple, mais c'est trop tard pour le vieil homme comme pour la jeune fille.
Plus rares que les images cristal, les travellings de Visconti opèrent parfois une temporalisation de l'image et forment une image temps directe. "Plutôt qu'un mouvement physique, il s'agit surtout d'un déplacement dans le temps" (Prédal). Au début de Sandra, quand l'héroïne retourne à sa maison natale, et s'arrête pour acheter le fichu noir dont elle se couvrira la tête, et la galette qu'elle mangera comme une nourriture magique, elle ne parcourt pas de l'espace, elle s'enfonce dans le temps.
Thèmes qui unissent Visconti à Proust : le monde cristallin des aristocrates ; sa décomposition interne ; l'Histoire vue de biais (l'affaire Dreyfus, la guerre de 14 ; le trop tard du temps perdu, mais qui donne aussi bien l'unité de l'art ou le temps retrouvé ; les classes définies comme familles d'esprit plutôt que comme groupes sociaux.
Bibliographie : Gilles Deleuze, l'Image-temps
| 1943 | Ossessione |
 |
Avec : Clara Calamai (Giovanna), Massimo Girotti (Gino Costa), Juan De Landa (Bragana). 2h20.
Sur la route nationale qui longe le Pô, vers Ferrare, un café-garage-station-essence... Arrive un jour Gino, chômeur et vagabond, que le patron, Bragana, d'abord méfiant, prend en amitié lorsqu'il constate que Gino est un excellent mécanicien. Très vite, ce dernier devient l'amant de la femme de Bragana, Giovanna, et lui propose de l'emmener avec lui....
|
| 1948 | La terre tremble  |
 | (La Terra Trema). Avec : Antonio Arcidiacono (Toni), Giuseppe Arcidiacono (Cola), Rosa Costanzo (Nedda). 2h32.
Rentré au pays après la guerre, Toni, fils aîné d'une famille sicilienne de pêcheurs fort pauvres, a des idées qu'il a ramenées de son séjour sur le continent. Il courtise Nedda, mais les parents de la jeune fille, relativement aisés, ne veulent pas d'un homme de sa classe, la dernière. Tom, après une première révolte qui échoue, décide de devenir propriétaire de sa barque et de ses outils de travail...
|
| 1951 | Bellissima |
 | Avec : Anna Magnani (Maddalena Cecconi), Walter Chiari (Alberto Annovazzi), Tina Apicella (Maria Cecconi). 1h48.
Un concours est organisé à Cinecitta pour trouver une enfant qui pourrait être l'héroïne du nouveau film de Blasetti. Toutes les mères, en quête de gloire et d'argent, se présentent le jour J avec leurs progénitures tirées à quatre épingles. Au moment où l'une d'elles, Maddalena, s'apprête à entrer sur le plateau, elle s'aperçoit que sa fille Maria, a disparu. Elle la retrouve près d'une piscine complètement décoiffée et salie....
|
| 1954 | Senso |
 |
Avec : Alida Valli (comtesse Livia Serpieri), Farley Granger (lieutenant Franz Malher) Massimo Girotti (marquis Ussoni). 2h05
Venise printemps 1866. Les derniers jours de l'occupation autrichienne. Au théâtre de la Fenice, à la fin du troisième acte du trouvère de Verdi, une manifestation anti-autrichienne éclate. L'un des organisateurs, le comte Roberto Ussoni, défie en duel un lieutenant autrichien, Franz Mahler, qui a prononcé des paroles insultantes pour les Italiens. La comtesse Livia Serpieri, cousine d'Ussoni et qui partage en principe son idéal patriotique, prie le lieutenant Malher, présent dans sa loge, de ne pas relever le défi....
|
| 1957 | Nuits blanches  |
 | (Le Notti Bianche). Avec : Marcello Mastroianni (Mario), Maria Schell (Natalia), Jean Marais (Le locataire). 1h40.
Une nuit, près d'un canal, Mario, un jeune employé de bureau, rencontre Natalia, une jeune fille dont le comportement étrange et changeant le rend curieux puis l'attire. Il la revoit le soir suivant et apprend qu'elle vit seule avec sa vieille grand-mère presque aveugle, qu'elles subsistent en fabriquant des tapis et en louant des chambres de leur maison et qu'il y a un an elle est tombée amoureuse d'un locataire...
|
| 1960 | Rocco et ses frères |
 | (Rocco e i suoi Fratelli). Avec : Avec : Alain Delon (Rocco Parondi), Renato Salvatori (Simone Parondi), Annie Girardot (Nadia). 2h57.
Quittant leur province pauvre en talie du Sud, la famille Parondi - Rosaria, la mère veuve, et ses cinq fils, Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro et Luca - vient s'établir à Milan. Vincenzo se marie. Simone s'entraîne pour devenir boxeur. Rocco est employé dans une teinturerie. Ciro suit des cours du soir tout en travaillant pour devenir ouvrier spécialise.L'harmonie de la famille va être perturbée par l'entrée en scène de Nadia, une fille de la ville...
|
| 1961 | Le travail |
 |
Episode de Bocacce 70, film à sketches de Federico Fellini , Luchino Visconti (Le Travail) et Vittorio De Sica. Avec : Romy Schneider.
Le Comte Ottavio a dépensé une partie de la fortune de sa femme Pupé dans une affaire de call-girls. Pupé décide, pour récupérer son argent, de se mettre au travail : son époux devra la payer chaque fois qu'elle se donnera à lui.
|
| 1963 | Le guépard |
 | (Il gattopardo). Avec : Burt Lancaster (Fabrizio Salina), Claudia Cardinale (Angelica Sedara), Alain Delon (Tancredi Falconeri). 3h07.
1860. La Sicile est la proie des luttes intestines déclenchées par Garibaldi et ses "chemises rouges". Tandis que les hommes du chef révolutionnaire débarquent dans l'île, le prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa résidence secondaire de Donnafugata. Son neveu Tancrède, qu'il estime, s'est engagé dans les rangs de Garibaldi.
|
| 1965 | Sandra |
 | (Vaghe stelle dell'Orsa). Avec : Claudia Cardinale (Sandra Dawson), Jean Sorel (Gianni), Michael Craig (Andrew Dawson). 1h45.
Les époux Dawson, Andrew et Sandra, quittent Genève pour un court voyage à Volterra, ville natale de Sandra. Cette dernière doit faire don à la Municipalité du jardin familial qui deviendra un parc public. Ce parc portera le nom du père de Sandra, savant juif, mort en camp de concentration....
|
| 1967 | La sorcière brûlée vive |
 | (La Strega Bruciata viva). Episode de Les sorcières, film collectif en cinq segments de Franco Rossi, Vittorio de Sica, Mauro Bolognini, Pier Paolo Pasolini et Luchino Visconti. Avec : Silvana Mangano ( Gloria) Annie Girardot (Valeria), Francisco Rabal (Le mari de Valeria), Massimo Girotti (Le sportif), Véronique Vendell, Elsa Albani, Clara Calamai, Marilù Tolo, Nora Ricci, Dino Mele, Helmut Berger. |
| 1967 | L'étranger |
 | (Lo Straniero). Avec : Marcello Mastroianni (Arthur Meursault), Anna Karina (Marie Cardona), Bernard Blier (l'avocat). 1h44.
Alger, 1935. Meursault, modeste employé, assiste aux obsèques de sa mère morte dans un hospice sans manifester de douleur. Le lendemain, il passe la journée avec une jeune et jolie collègue, Marie Cardona. Il reprend ensuite sa vie de toujours, monotone, qu'interrompt un jour un voisin, Raymond, dont il ne s'est jamais occupé. Celui-ci s'étant querellé avec sa maîtresse le prie de lui écrire une lettre....
|
| 1969 | Les damnés |
 | (La Caduta degli dei). Avec : Dirk Bogarde (Friedrich), Ingrid Thulin (Sophie), Helmut Berger (Martin), Charlotte Rampling (Elisabeth), Renaud Verley (Günther). 2h30.
Le 27 février 1933, dans une grande ville de la Ruhr, toute la puissante famille Von Essenbeck est réunie pour fêter l'anniversaire du vieux chef de la famille, le Baron Joachim, magnat des aciéries. Dans la soirée, ils apprennent l'incendie du Reichtag : les nazis prennent le pouvoir. Aschenbach, membre des S.S. de Himmler, encourage Friedrich Bruckman, directeur des aciéries et amant de la Baronne Sophie, à opter pour Hitler. Bruckman assassine le Baron et accuse du meurtre Herbert Thallman, un libéral anti-nazi, époux de la nièce du Baron, Elisabeth, qui doit fuir le pays. Devenu majoritaire, le fils de Sophie, Martin, donne les pleins pouvoirs à Bruckman au grand dépit du Baron Konstantip qui voudrait assurer l'avenir de son jeune fils Guenther. Aschenbach suggère à Bruckman de se débarrasser de Konstantin et de ses S.A. A la tête des S.S., au cours de la "Nuit des longs couteaux", ils surprennent les S.A. en pleine orgie, et les massacrent tous, Bruckman s'occupant personnellement de Konstantin. Aschenbach trouve cependant Bruckman trop mou et excite contre lui la jalousie de Martin. Herbert Thallman vient se livrer pour sauver ses deux filles internées dans un camp de concentration, où est morte Elisabeth. Il accuse Sophie de les avoir dénoncées après sa fuite. Martin révèle à Guenther que Bruckman a tué son père, et Guenther rejoint le parti nazi. Martin, devenu le chef incontesté de sa famille, organise avec ses amis nazis le pseudo-mariage de sa mère avec Bruckman, et, à l'issue d'une cérémonie caricaturale, les force à se suicider.
|
| 1971 | Mort à Venise |
 | (Morte a Venezia). Avec : Dirk Bogarde (Gustav von Aschenbach), Björn Andrésen (Tadzio), Romolo Valli (le gérant de l'hotel). 2h11.
Le professeur Gustav von Aschenbach - compositeur de musique - débarque sur l'île du Lido (Venise) et s'installe à l'Hôtel des Bains. C'est un établissement de luxe fréquenté par le meilleur monde. Fatigué, malade, le professeur berce sa solitude, convoque ses souvenirs et observe les clients. Il remarque une famille polonaise et surtout un adolescent aux traits fins, Tadzio. Troublants échanges de regards entre l'homme et l'enfant...
|
| 1973 | Ludwig ou le crépuscule des dieux |
 | (Ludwig). Avec : Helmut Berger (Ludwig), Trevor Howard (Richard Wagner), Silvana Mangano (Cosima Von Buelow). 4h05.
Lorsqu'il monte sur le trône de Bavière, Louis, est âgé de dix-neuf ans. Passionné de littérature et de musique, la politique ne l'intéresse nullement. En mai 1864, il fait la connaissance du dieu de ses rêves : Richard Wagner, du chef d'orchestre Hans von Bülow et de sa femme Cosima, qui est la fille de Liszt. Louis se désintéresse de la guerre déclarée avec la Prusse qui, sous l'impulsion de Bismark, procède à l'irrésistible unification allemande en vassalisant tous les autres royaumes ou principautés germaniques, Bavière y compris.Louis s'attache à sa cousine, l'impératrice d'Autriche, qu'il adore. L’insaisissable Sissi, partage son gôut de la poésie Elle comprend l’indifférence et le dégoût de Ludwig pour la politique. Mais Sissi aime les voyages et la liberté. Elle tente de lui faire épouser sa soeur, Sophie, Duchesse de Bavière. Ludwig annonce ses fiançailles mais refuse toutefois d'épouser Sophie et fait de Richard Horning, son palefrenier devenu son amant, son chambellan et homme de confiance. Louis subvient aux besoins de Richard wagner pour sa vie et ses opéras dispendieux, mais il ignore les relations entre Richard et Cosima. Il se sent trahi lorsqu'il apprend la vérité et invite le compositeur à quitter Munich.Louis II commande la construction de plusieurs châteaux. Méprisé par ses ministres, le roi se retire dans ses châteaux et invite l'acteur Joseph Kainz dont il est épris. Une enquête signée par plusieurs médecins le déclare fou et Louis se trouve interné au château de Berg par le gouvernement effectif de Munich. Le 13 juin 1886, au soir, il sort en promenade accompagné du professeur Gudden. Plus tard, les corps des deux hommes seront retrouvés dans le lac.
|
| 1974 | Violence et passion |
 | (Gruppodi Famiglia in un Interno). Avec : Burt Lancaster (le professeur), Silvana Mangano (Bianca), Helmut Berger (Konrad). 2h02.
Le professeur a soixante-cinq ans. Autrefois, il enseignait les sciences mais a abandonné lorsqu'il a compris l'usage destructeur qui en était fait. Il a aussi été marié, mais cette union s'est soldée par un échec. Le professeur tente, en vain, de s'opposer à la volonté de Bianca Brumonti de lui louer l'étage supérieur de son appartement.
|
| 1976 | L'innocent |
| (L'innocente). Avec : Giancarlo Giannini (Tullio Hermil), Laura Antonelli (Giuliana Hermil), Jennifer O'Neill (Teresa Raffo). 2h08.
Tullio entend bien vivre en défiant en permanence les règles de la morale courante et à Rome, à la fin du siècle dernier, celle ci est particulièrement stricte, surtout dans le milieu privilégié de la famille Hermil. C'est ainsi qu'il a décidé de ne plus avoir de rapports conjugaux avec sa femme Giuliana qu'il considère désormais comme une amie et confidente à qui il peut raconter tout de sa passion avec la comtesse Raffo....
===============================================
Biografia (W.it.)Villa Erba, residenza di Visconti a Cernobbio Figlio quartogenito del duca Giuseppe Visconti di Modrone e di Carla Erba, proprietaria della più grande casa farmaceutica italiana, fratello minore di Guido, Luigi ed Edoardo, maggiore di Giovanna, Nane e Uberta, è discendente collaterale di Francesco Bernardino Visconti, cui, secondo talun filòlogo, Manzoni si sarebbe ispirato per delineare la figura letteraria, d'invenzione, dell'Innominato. Fu nipote di tre senatori del Regno: il nonno Guido Visconti di Modrone e i due zii paterni Uberto Visconti di Modrone e Guido Carlo Visconti di Modrone. Presta servizio militare come sottufficiale di cavalleria a Pinerolo e vive gli anni della sua gioventù nell'agio di una delle più importanti famiglie d'Europa. Frequenta, con alterni risultati[2], il liceo classico Berchet di Milano, dove viene bocciato al ginnasio, passa poi al Liceo classico Dante Alighieri diretto dalla famiglia Pollini. A soli 26 anni, Luchino guiderà una scuderia di cavalli di sua proprietà raggiungendo ottimi risultati tra i quali si ricorderà la vittoria nel Gran Premio di Milano San Siro con Sanzio[3]. Fin da ragazzo studia violoncello, sotto la guida del violoncellista e compositore Lorenzo de Paolis (1890 - 1965), ed è influenzato dal mondo della lirica e del melodramma: il padre è infatti uno dei finanziatori del Teatro alla Scala di Milano e il salotto di casa Visconti è frequentato, tra gli altri, da Arturo Toscanini. Numerosi artisti vengono ospitati anche nella residenza cernobbiese di Villa Erba, sul Lago di Como, dove il giovane Visconti trascorre saltuariamente le vacanze estive con la madre Carla. Così la ricorda il regista: «Villa Erba è una casa che noi amiamo moltissimo. Ci riuniremo tutti là, fratelli e sorelle e sarà come al tempo in cui eravamo bambini e vivevamo all'ombra di nostra madre» Villa Godi Malinverni, la tenuta di campagna di Alida Valli nel film "Senso". Nella Villa Godi Malinverni è ancora custodita la carrozza utilizzata nel film. La carriera cinematografica di Visconti ha inizio nel 1936 a Parigi, come assistente alla regia e ai costumi per Jean Renoir, conosciuto attraverso la stilista Coco Chanel, con la quale Luchino ha una relazione. È l'epoca del 'Fronte Popolare' che porta i partiti progressisti al governo in Francia. In questo clima Visconti entra in contatto con alcuni militanti antifascisti fuoriusciti dall'Italia, con intellettuali come Jean Cocteau e attraverso lo stesso Renoir, convinto comunista, si avvicina alle posizioni della sinistra. Al fianco del grande regista francese Visconti contribuisce alla realizzazione di Les basfonds e di Une partie de campagne. Visconti in seguito riconoscerà sempre l'influenza del realismo di Renoir e del cinema francese degli anni '30 sulla sua opera di regista. Dopo un breve soggiorno a Hollywood, rientra in Italia nel 1939 a causa della morte della madre. Luchino Visconti durante le prove di Anna Bolena al Teatro alla Scala di Milano, fotografia di Federico Patellani, 1957 Comincia, invitato di nuovo da Jean Renoir a lavorare a una coproduzione italo-francese, un adattamento cinematografico della Tosca ma, dopo l'inizio della guerra, il regista francese è costretto a lasciare il set, e viene sostituito dal tedesco Karl Koch. Dopo la scomparsa della madre si stabilisce a Roma e qui l'incontro con i giovani intellettuali collaboratori della rivista Cinema sarà fondamentale. In questo momento si avvicina, grazie a questi intellettuali, all'illegale Partito Comunista Italiano al quale rimarrà legato, con rapporti alterni[4][5], fino alla morte. Da questo gruppo nasce una nuova idea di cinema che, abbandonando le melense commedie del cinema dei telefoni bianchi ambientate in ville lussuose, racconta realisticamente la vita e i drammi quotidiani della gente. Su queste basi, insieme con Pietro Ingrao, Mario Alicata e Giuseppe De Santis, nel 1942 Visconti mette in cantiere il suo primo film: Ossessione, ispirato al romanzo Il postino suona sempre due volte di James Cain. Protagonisti sono Clara Calamai, che sostituisce all'ultimo momento Anna Magnani costretta ad abbandonare il progetto perché in stato di avanzata gravidanza, Massimo Girotti, nella parte del meccanico Gino, Juan de Landa, nel ruolo del marito tradito, ed Elio Marcuzzo nel personaggio de «Lo spagnolo». La vicenda comincia in un'osteria che sorge lungo una strada della bassa padana, poi si sposta ad Ancona e infine a Ferrara. La scelta di girare il film in queste città era controcorrente per l'epoca e dà al film un tono di realtà quotidiana che sorprese allora e continua a sorprendere. Con Ossessione Visconti dà inizio al genere cinematografico del Neorealismo. È proprio il montatore del film, Mario Serandrei, che darà per primo al film la definizione di 'neorealista', ufficializzando così la nascita di uno stile espressivo che avrà grande fortuna negli anni seguenti. Il film ha una distribuzione discontinua e tormentata in un'Italia sconvolta dalla guerra. Prima del 1943, e quindi prima della realizzazione del film Ossessione, Luchino Visconti, con Gianni Puccini, Giuseppe De Santis e Mario Alicata, aveva in animo di produrre un film tratto da un racconto di Giovanni Verga imperniato sulla vicenda di un contadino che alla fine del secolo scorso diventa bandito: L'amante di Gramigna. A sceneggiatura ultimata il Ministero della Cultura Popolare, nella persona di Alessandro Pavolini, non diede il nulla osta, anzi Pavolini di suo pugno scrisse sulla copertina della sceneggiatura: "Basta con i banditi!". Dopo l'armistizio dell'otto settembre, Visconti collabora con la Resistenza assumendo il nome di battaglia di Alfredo[6]. Datosi alla latitanza, invita l'attrice María Denis, con la quale ha una relazione, a offrire ospitalità nella sua villa a tutti gli antifascisti che si presentavano con la parola d'ordine « per conto di chi sai tu »[7]. «La casa di Luchino divenne in breve tempo la centrale operativa ed il rifugio di tantissimi clandestini...Tutte le finestre venivano tenute rigorosamente sbarrate ed oscurate, in modo che dall'esterno la casa risultasse come disabitata, mentre all'interno era stata trasformata in una specie di dormitorio, mensa e ufficio, i cui occupanti entravano e uscivano rigorosamente di notte.» (Lettera di Uberta Visconti a Martino Contu, 6 febbraio 1996[8]) Tra coloro che troveranno rifugio nella sua dimora vi fu il comunista sardo Sisinnio Mocci, ufficialmente assunto come maggiordomo ma in realtà impegnato nella lotta clandestina contro l'occupazione nazifascista di Roma; Mocci sarà arrestato nella villa di Visconti e poi trucidato alle Fosse Ardeatine[9]. Catturato nell'aprile del '44 e imprigionato a Roma per alcuni giorni dalla Banda Koch, durante l'occupazione tedesca, Visconti si salva dalla fucilazione grazie all'intervento di María Denis, che intercederà per lui presso la polizia fascista. La Denis racconterà poi quest'esperienza nel suo libro di memorie, Il gioco della verità. Pietro Koch il capo della formazione da cui il regista era stato fatto prigioniero, fu fucilato presso il Forte Bravetta a Roma il 5 giugno 1945; la testimonianza del regista ebbe forte peso al processo da cui uscì la condanna a morte per il noto fascista. Vista la fama del personaggio, le autorità ritennero opportuno documentare l'esecuzione con una ripresa filmata che venne realizzata dallo stesso Luchino Visconti. Alla fine del conflitto Visconti collabora alla realizzazione del documentario Giorni di gloria, un film di regia collettiva dedicato alla Resistenza. Visconti gira le scene del linciaggio di Donato Carretta, l'ex direttore del carcere di Regina Coeli, e (come detto) cura la regia della fucilazione di Pietro Koch. Altre sequenze vengono girate da Gianni Puccini e Giuseppe De Santis. Nello stesso tempo si dedica all'allestimento di drammi in prosa con assolute prime rappresentazioni (rimase leggendaria la compagnia formata con Paolo Stoppa e Rina Morelli) e, negli anni cinquanta, anche alla regia di melodrammi lirici, avendo l'opportunità di dirigere Maria Callas Meneghini, nel 1955, con La Sonnambula e La Traviata alla Scala. Nel 1948 torna dietro la macchina da presa realizzando un film polemico e crudo, che denuncia apertamente le condizioni sociali delle classi più povere, La terra trema, adattamento dal romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga, di stampo quasi documentaristico. È uno dei pochi film italiani interamente parlati in dialetto. Nel 1950 vi fu una seconda edizione del film doppiata in lingua italiana. Bellissima del 1951, tratto da un soggetto di Cesare Zavattini, con Anna Magnani e Walter Chiari, analizza con spietatezza il 'dietro le quinte' del mondo cinematografico. Siamo donne del 1953, sempre tratto da un soggetto di Zavattini, mostra un episodio della vita privata di quattro attrici celebri (Anna Magnani, Alida Valli, Ingrid Bergman e Isa Miranda). Nel 1954 realizza il suo primo film a colori, Senso, ispirato a un racconto di Camillo Boito, con Alida Valli e Farley Granger. Siamo nel 1866: una nobildonna veneta si innamora di un ufficiale dell'esercito austriaco. Scoperto il tradimento dell'uomo, al quale aveva donato il denaro che doveva servire a una causa patriottica, si trasforma in delatrice e lo fa condannare alla fucilazione. Questo film segna una svolta nell'arte di Visconti, qualcuno lo definirà impropriamente un tradimento del neorealismo: la cura del dettaglio scenografico è estrema. Nel 1956 è tra gli intellettuali comunisti che manifestano contro l'invasione sovietica d'Ungheria, ma non lascia il partito. Le notti bianche del 1957, ispirato al romanzo di Dostoevskij, interpretato da Marcello Mastroianni, Maria Schell e Jean Marais, è un film in bianco e nero, dall'atmosfera plumbea e nebbiosa. Vince il Leone d'argento a Venezia. Rocco e i suoi fratelli, del 1960, è la storia di una famiglia di meridionali che dalla Basilicata si trasferisce per lavoro a Milano. Narrato con i toni della tragedia greca, il film provoca grandi polemiche a causa di alcune scene crude e violente oltreché per le posizioni politiche del regista. Vicino al Partito comunista fin dai tempi della Resistenza, Visconti è ormai soprannominato 'il Conte rosso'. Il film vince comunque il Gran Premio della Giuria a Venezia. L'anno seguente, insieme con Vittorio De Sica, Federico Fellini e Mario Monicelli realizza il film a episodi Boccaccio '70. L'episodio di Visconti, Il lavoro, è interpretato da Tomas Milian, Romy Schneider, Romolo Valli e Paolo Stoppa. Nel 1962 Visconti mette d'accordo critica e pubblico con Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vincitore della Palma d'oro. Interpretato fra gli altri da Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, è ambientato nel periodo dello sbarco dei garibaldini in Sicilia. Il culmine del film è la scena finale del ballo, che occupa l'ultima mezz'ora della pellicola. Riscuote grande successo anche in Europa, mentre alla prima uscita negli Stati Uniti, nonostante la presenza di Lancaster, il film ha uno scarso riscontro al botteghino. Nel 1965 esce il film Vaghe stelle dell'Orsa, ispirata nel titolo a Leopardi. È la storia di un incesto, con richiami alla mitologia, ai tragici greci e a taluni percorsi culturali del novecento, interpretata da Claudia Cardinale e Jean Sorel. Nel 1966 Visconti gira La strega bruciata viva, un episodio del film collettivo Le streghe, interpretato da Silvana Mangano. Del 1967 è Lo straniero, ispirato al libro di Albert Camus, con Marcello Mastroianni e la partecipazione di Angela Luce. Durante le riprese di Vaghe stelle dell'Orsa (1964) a Visconti viene presentato il giovane Helmut Berger, che diverrà negli anni uno degli 'attori - simbolo' del suo cinema, come già Delon o Claudia Cardinale. Alla fine degli anni sessanta Visconti, ispirandosi al dibattito storiografico postnazista, realizza La caduta degli Dei (1969), con Dirk Bogarde, Helmut Berger e Ingrid Thulin come protagonisti. La storia è quella dell'ascesa e caduta della famiglia proprietaria delle più importanti acciaierie tedesche all'avvento del nazismo. Il film costituisce il primo tassello di quella che sarà poi definita la 'trilogia tedesca'. Gli altri due film saranno Morte a Venezia del (1971) e Ludwig del 1972. Morte a Venezia è tratto dal lavoro omonimo di Thomas Mann con la collaborazione del costumista Piero Tosi e la sceneggiatura di Nicola Badalucco e dello stesso Luchino. Nel film, Luchino Visconti racconta in maniera intensa e poetica la vicenda del compositore Gustav von Aschenbach, esplorando il tema di una bellezza ideale e irraggiungibile, da sottolineare la grande interpretazione degli attori Dirk Bogarde nella parte di Aschenbach e di Björn Andrésen nel ruolo di Tadzio. Infine, Ludwig, ancora con Helmut Berger nel ruolo principale, uno dei film più lunghi della storia del cinema italiano (dura oltre 3 ore e 40 minuti nella sua versione integrale) che narra la storia del monarca di Baviera, Ludwig II, e del suo tempestoso rapporto con Richard Wagner nonché del suo progressivo ritirarsi dalla realtà e dalle responsabilità di governo fino alla destituzione e alla morte in circostanze misteriose. La 'trilogia' avrebbe potuto diventare 'tetralogia' con La montagna incantata, un altro lavoro di Mann, alla cui trasposizione cinematografica Visconti è interessato. Ma il 27 luglio 1972, quando sono ormai terminate le riprese del Ludwig ma non ancora cominciato il montaggio, il regista viene colto da un ictus cerebrale che lo lascia paralizzato nella parte sinistra del corpo. Il montaggio di Ludwig viene terminato a Cernobbio. Malgrado le condizioni di salute, ritorna a lavorare curando nel 1973 un celebre allestimento della Manon Lescaut per il Festival dei Due Mondi di Spoleto diretto da Romolo Valli e, nonostante le grandi difficoltà, riesce a girare due ultimi film, Gruppo di famiglia in un interno (1974), scopertamente autobiografico e di nuovo interpretato da Burt Lancaster e Helmut Berger, e il crepuscolare L'innocente (1976), tratto dal romanzo omonimo di Gabriele d'Annunzio, interpretato da Giancarlo Giannini e Laura Antonelli. Luchino Visconti muore nella primavera del 1976, colto da una forma grave di trombosi poco dopo aver visto insieme con i suoi più stretti collaboratori il primo montaggio del film a cui stava ancora lavorando. L'innocente verrà presentato al pubblico in quella veste, a parte alcune modifiche apportate dalla co-sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico sulla base di indicazioni del regista durante una discussione di lavoro. La sua regia del 1958 di Don Carlo al Royal Opera House, Covent Garden di Londra è stata utilizzata fino al 2002. Le ceneri sono conservate dal 2003 sotto una roccia sull'isola d'Ischia, nella sua storica residenza estiva "La Colombaia", assieme a quelle della sorella Uberta.[10] Vita privata Accanto alle storie d'amore vissute in anni diversi con Coco Chanel, Clara Calamai, Maria Denis, Marlene Dietrich e con la scrittrice Elsa Morante, il regista non ha mai nascosto un suo orientamento omosessuale[11][12], che trova riferimenti espliciti in molti dei suoi film come in alcuni degli allestimenti teatrali di cui negli anni ha curato la regia. Negli anni trenta, a Parigi, Visconti ebbe una relazione con il fotografo Horst P. Horst[13][14]. Tra il finire degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, nel pieno della sua consacrazione professionale, intrecciò la sua storia umana e lavorativa con quella dello scenografo dei suoi spettacoli, Franco Zeffirelli, che visse per un lungo periodo nella villa del regista sulla via Salaria a Roma[15][16]. Nel 1956 tiene a battesimo il figlioccio Miguel Bosè. Dopo il 1965 Visconti fu legato da un'intensa relazione all'attore Helmut Berger: tale relazione proseguì, tra gli alti e bassi dovuti al vivace stile di vita dell'attore austriaco, fino alla morte del regista[17][18]. Filmografia Aiuto regista Verso la vita (Les basfonds) di Jean Renoir (1936) La scampagnata (Une partie de campagne) di Jean Renoir (1936) La Tosca di Jean Renoir e Carl Koch (1941) Regista Film Ossessione (1943) La terra trema (1948) Bellissima (1951) Siamo donne (1953) - episodio Anna Magnani Senso (1954) Le notti bianche (1957) Rocco e i suoi fratelli (1960) Boccaccio '70 (1962) - episodio Il lavoro Il Gattopardo (1963) Vaghe stelle dell'Orsa (1965) Le streghe (1967) - episodio La strega bruciata viva Lo straniero (1967) La caduta degli dei (1969) Morte a Venezia (1971) Ludwig (1973) Gruppo di famiglia in un interno (1974) L'innocente (1976) Documentari Giorni di gloria (1945) Documentario Appunti su un fatto di cronaca (1951) Documentario Alla ricerca di Tadzio (1970) Documentario ========================================================= Regista di teatro di prosa Collaborazioni (teatro di prosa) Regia di opere liriche Balletti ========================================================= (W.fr.) Début de carrière Sa carrière cinématographique débuta en 1936, en France, où il travailla aux côtés de Jean Renoir (rencontré grâce à Coco Chanel) comme assistant, à la réalisation et au choix des costumes de deux de ses œuvres, Les Bas-fonds et Partie de campagne. Le souci de réalisme du grand cinéaste français le marqua profondément. Toujours en France, il rencontra des réfugiés italiens, militants de gauche, au contact desquels ses convictions politiques changèrent radicalement. Après un bref séjour à Hollywood, il rentra en Italie en 1939 à cause du décès de sa mère. Avec Renoir, il commença à travailler à une adaptation cinématographique de La Tosca, mais, quand éclata la guerre, le réalisateur français fut contraint d'abandonner le tournage — il fut remplacé par l'Allemand Carl Koch. La rencontre avec certains jeunes intellectuels et critiques, collaborateurs à la revue Cinema (fondée, ironie du sort, par un fils de Benito Mussolini, Vittorio), fit germer dans son esprit l'idée d'un cinéma qui raconterait de façon réaliste la vie et les drames quotidiens du peuple, cinéma qui serait en rupture avec les mièvreries clinquantes et édulcorées des comédies du cinema dei telefoni bianchi (littéralement « cinéma des téléphones blancs »). À cette époque, il rencontra Roberto Rossellini et, probablement, Federico Fellini. Visconti projeta de réaliser l'adaptation du roman Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier et celle des Malavoglia de Verga, mais ces projets avortèrent. Ossessione (Les Amants diaboliques) Partant de cette idée, il signa en 1942, avec Giuseppe De Santis, Gianni Puccini, Antonio Pietrangeli, Mario Serandrei et Rosario Assunto, son premier film, une des œuvres majeures du néo-réalisme : Ossessione (Les Amants diaboliques), inspiré du célèbre roman The Postman always rings twice (Le facteur sonne toujours deux fois) de James M. Cain, avec, comme acteurs principaux, la sulfureuse Clara Calamai (elle remplaça au dernier moment Anna Magnani, initialement destinée au rôle trouble de Giovanna) et Massimo Girotti dans le rôle du mécanicien, Gino. Un second projet, une adaptation de L'Amante di Gramigna de Giovanni Verga, ne put être mené à bien, la guerre s'intensifiant. Capturé et emprisonné, Visconti échappa au peloton d'exécution grâce à l'intervention de l'actrice María Denis qui raconte cette expérience dans son autobiographie Il Gioco della verità (Le Jeu de la vérité). À la fin du conflit, Visconti participa aux côtés de Mario Serandrei à la réalisation du documentaire Giorni di gloria (Jours de gloire), consacré à la Résistance et à la Libération. Parallèlement, il monta des créations théâtrales (la compagnie formée avec Paolo Stoppa et Rina Morelli est restée légendaire, Vittorio Gassman les y rejoignit), ainsi que des mises en scène lyriques, son rêve d'une vie. Il dirigea Maria Callas, en 1955, dans La Sonnambula (La Somnanbule) de Vincenzo Bellini, et La traviata de Giuseppe Verdi. La Terra trema (La Terre tremble) En 1948, il revint derrière la caméra pour réaliser La Terra trema (La Terre tremble), un film polémique dénonçant ouvertement les conditions sociales des classes les plus défavorisées. C'était une adaptation du roman I Malavoglia de Giovanni Verga, de facture quasi documentaire, aux images splendides, mais de compréhension rendue difficile par l'utilisation du plus pur dialecte sicilien (précisément celui des pêcheurs d'Aci Trezza près de Catane). Le film ne reçut les faveurs du public ni à sa sortie, ni deux ans plus tard, en 1950, quand parut une seconde version doublée en italien. Dans toute l'histoire du cinéma péninsulaire, seuls quatre films furent entièrement tournés en dialecte et sous-titrés en italien : La Terra trema fut le premier ; les autres, L'Arbre aux sabots (L'Albero degli zoccoli) (1978) d'Ermanno Olmi, en dialecte bergamasque, Giro di lune tra terra e mare (1997) de Giuseppe Gaudino, en dialecte campanien avec des citations latines, et enfin, LaCapaGira (2001) d'Alessandro Piva, en dialecte apulien. Bellissima Luchino Visconti et Anna Magnani Plus captivante pour le public fut sa troisième œuvre, Bellissima, (1951), écrite par Cesare Zavattini, une analyse sans concession des coulisses du monde clinquant du cinéma, avec l'une des actrices symboles du néo-réalisme italien, Anna Magnani, aux côtés de Walter Chiari ; y participèrent également le réalisateur Alessandro Blasetti, responsable des castings, et le présentateur Corrado Mantoni, dans son propre rôle. Visconti réalisa l'année suivante l'épisode Anna Magnani du film Siamo donne, tiré d'une autre idée du bouillonnant Zavattini, celle de montrer des épisodes de la vie privée de quatre actrices célèbres (outre Magnani, on trouve Alida Valli, Ingrid Bergman et Isa Miranda), suivis de castings d'un concours de recherche de nouveaux visages féminins à lancer au cinéma. Senso En 1954, il réalisa son premier film en couleurs, Senso (librement tiré d'un récit de Camillo Boito), qui signa un tournant dans sa carrière, et que nombre de critiques interprétèrent comme une trahison du néo-réalisme. Grande fresque historique relue de manière critique dans le contexte de l'analyse d'un drame privé, extrêmement recherchée dans le soin des détails du décor et dans la mise en scène (soin pour lequel Visconti fut reconnu unanimement comme un maître ; seul Franco Zeffirelli, son amant et élève déclaré, le suivit dans cette voie), Senso inaugura une série de films complexes et fascinants, imprégnés de violence et de tensions, toujours controversés par le public et par la critique ; la décadence humaine, morale et physique, y devint un leitmotiv qu'il déclina jusqu'à la fin de sa carrière. Dans Senso, à l'époque de l'Italie du Risorgimento affrontant l'Autriche qui occupe toujours la Vénétie, et de la défaite de Custoza, une aristocrate vénitienne (Alida Valli), tombe éperdument amoureuse d'un officier de l'armée autrichienne (Farley Granger), qui ne songe, lui, qu'au moyen de s'échapper de l'armée grâce à l'argent que sa noble maîtresse pourrait lui procurer, ce qu'elle effectue en lui donnant le « trésor de guerre » des patriotes italiens ; se découvrant bafouée, elle dénonce son amant déserteur et le fait condamner au peloton d'exécution, avant de perdre la raison. Le film de Visconti fut l'objet d'importantes polémiques à la Mostra de Venise, et, au cours d'une soirée tumultueuse d'attribution des prix, il fut complètement ignoré par la critique, laquelle préféra attribuer le Lion d'or à Renato Castellani avec Giulietta e Romeo. Le film est important pour avoir rendu populaire la Symphonie nº 7 de Bruckner, utilisée par Visconti dans la bande sonore, comme il fera plus tard, avec l'Adagietto de la Cinquième de Gustav Mahler dans Mort à Venise. Le Notti bianche (Les Nuits blanches) En 1957, Luchino Visconti remporta le Lion d'Argent grâce à Le Notti bianche (Les Nuits blanches), tendre et délicate histoire d'amour inspirée du roman de Dostoïevski, interprétée par Marcello Mastroianni, Maria Schell et Jean Marais (avec la participation spéciale de Clara Calamai), film photographié en noir et blanc dans une atmosphère de plomb et de brume, dans un port inspiré de celui de Livourne, intégralement reconstitué à Cinecittà. Rocco e i suoi fratelli (Rocco et ses frères) En 1960, il reçut le Prix spécial du jury de la Mostra pour Rocco e i suoi fratelli, (Rocco et ses frères), odyssée d'une famille méridionale émigrée à Milan pour y chercher du travail, film traité sur le mode de la tragédie grecque, mais inspiré des Frères Karamazov de Dostoïevski. Le film fit scandale à cause de certaines scènes extrêmement crues et violentes pour l'époque, à tel point que la censure conseilla aux projectionnistes de mettre leur main sur l'objectif pendant les scènes incriminées. Le scénario est de Vasco Pratolini, Suso Cecchi D'Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli et Luchino Visconti. L'année suivante, en 1961, il réalisa l'épisode Il lavoro (Le Travail) du film Boccace 70 auquel participèrent également Vittorio De Sica, Federico Fellini et Mario Monicelli. Visconti s'attaquait directement à la commission de censure qui avait malmené son film précédent. Il Gattopardo (Le Guépard) En 1962, il mit enfin d'accord les critiques et le public avec son plus grand succès, Il Gattopardo (Le Guépard), tiré du roman du même nom de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, et qui reçut la Palme d'or au Festival de Cannes. Le scénario est de Suso Cecchi D'Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli et Luchino Visconti. Interprété par une distribution éblouissante (Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon…), situé à l'époque du débarquement des partisans de Garibaldi en Sicile, le film relate les vicissitudes du prince Fabrizio Corbera di Salina (Burt Lancaster), grand propriétaire terrien contraint d'accepter l'union entre l'aristocratie désargentée et la nouvelle bourgeoisie, union atteignant son paroxysme dans la célébrissime scène finale du bal, laquelle occupe la dernière demi-heure du film, scène considérée unanimement comme le point d'orgue de l'art viscontien. Alberto Moravia s'exclama après avoir vu le film: « C'est le film de Visconti le plus pur, le plus équilibré et le plus exact ». Le film fut distribué aux États-Unis et en Angleterre par la Twentieth Century Fox, mais au prix d'importantes coupures. Période de transition En 1965, sortit le film Vaghe stelle dell'Orsa (Sandra), histoire d'un inceste au titre inspiré par Giacomo Leopardi, encore interprété par Claudia Cardinale, suivi de La Strega bruciata viva, un épisode du collectif Le Streghe (1966), suivi de Lo Straniero, (L'Étranger) (1967), inspiré par le livre éponyme d'Albert Camus, dans lequel il dirigeait à nouveau Marcello Mastroianni. La Tétralogie À la fin des années soixante, Visconti élabora le projet d'une tétralogie allemande s'inspirant des thématiques mythologiques et décadentes de Wagner et Thomas Mann. Sur les quatre titres prévus, il n'en réalisa que trois. La Caduta degli Dei (Les Damnés) La Caduta degli Dei (Les Damnés), (1969), en est le premier film. Il s'agit de l'ascension et de la chute des membres de l'une des familles propriétaires des plus importantes aciéries allemandes pendant la montée du nazisme. Ce film marquait, après un petit rôle de domestique dans le sketch viscontien des "Sorcières", le premier grand rôle à l'écran de Helmut Berger, égérie et dernier amant de Visconti. Morte a Venezia (Mort à Venise) Luchino Visconti et Björn Andrésen (Tadzio) sur le tournage de Mort à Venise. Le deuxième fut Morte a Venezia (Mort à Venise), (1971), tiré de la nouvelle de Thomas Mann, La mort à Venise, est une fresque sublime explorant le thème de l'inéluctabilité de la vieillesse et de la mort, associé à la quête de la beauté idéale et inaccessible, dans une Venise merveilleuse, progressivement enlaidie, abîmée par les mesures sanitaires dictées par le service de santé, lorsque se répand dans la ville une épidémie de choléra. Ludwig (Ludwig, le crépuscule des dieux) Le troisième et dernier volet fut Ludwig (Ludwig, le crépuscule des dieux), (1972), où Helmut Berger interpréta le rôle du jeune roi de Bavière, l'un des films les plus longs de l'histoire du cinéma (d'une durée de près de cinq heures dans sa version originale, plus précisément, d'après une version sortie en France en 1987, chez Ciné-Collection, en deux cassettes vidéo-VHS Secam, de 4 h et 42 minutes exactement ; toutes les autres versions sont incomplètes et mentent lorsqu'elles se prétendent intégrales) ; le film raconte l'histoire du roi Louis II de Bavière, la lente déchéance du jeune monarque idéaliste, visionnaire, qui préférait la rêverie, l'art, la beauté, l'amitié et l'amour aux charges du pouvoir, que nombre de ceux qu'il aimait trahirent, que son peuple trahit également, et qui finit par être interné ; il se noya, ainsi que son médecin, dans le lac de Starnberg, dans des circonstances mystérieuses. La Tétralogie aurait dû se terminer avec une nouvelle adaptation cinématographique d'une œuvre de Thomas Mann, La Montagna incantata (La Montagne magique). Durant le tournage de Ludwig, Visconti fut victime d'un accident vasculaire cérébral qui le laissa à moitié paralysé. Le testament et le dernier film Malgré sa pénible condition physique, il parvint à tourner ses deux derniers films, où les thèmes de la déchéance et de la solitude deviennent de plus en plus prégnants. Gruppo di famiglia in un interno (Violence et passion) Gruppo di famiglia in un interno (Violence et passion), 1974), inspiré à la fois par Mario Praz, Roberto Bazlen, est ouvertement autobiographique, interprété par Burt Lancaster et Helmut Berger, acteurs qu'il retrouve ici. L'Innocente (L'Innocent) Ce dernier film, crépusculaire malgré la jeunesse des personnages et la lumière de Rome et de la campagne romaine, L'Innocent (L'Innocente), (1976), est librement inspiré du roman de Gabriele D'Annunzio, L'Innocent, titre de la version littéraire italienne (1892), (L'Intrus dans sa traduction française). À sa sortie, la presse n'en fit pas grand cas, trompée peut-être par la société bourgeoise décrite dans le film, par les décors et les costumes de la fin du xixe siècle. Se trompant sur le sens du film, elle n'y vit pas ce qu'il contenait, l'analyse profonde du seul sentiment amoureux, sentiment universel, et de la dépendance qu'il implique, compliquée, douloureuse, voire destructrice. Dans L'Innocent, on assiste à la désagrégation d'un couple jeune, sans enfants, formé par Tullio Hermil (Giancarlo Giannini), le mari, qui préfère ses maîtresses à sa femme, et par Giulianna (Laura Antonelli), sa femme. Celle-ci, humiliée, lassée, tombe amoureuse d'un autre homme et attend de lui un enfant, qu'elle décide de garder. Tullio, qui dénonçait l'hypocrisie de la société et plaidait pour la liberté de pensée et de mœurs (ici, pour la liberté de l'avortement), est contraint d'attendre la naissance de l'enfant. Devenu amoureux de Giulanna jusqu'à l'obsession, il réalise qu'en ayant toujours refusé de l'aimer et de dépendre de ses sentiments, il avait tenté d'échapper ainsi à l'« emprisonnement » selon lui, du lien amoureux. Son amour, fou au point de le pousser à vouloir tuer l'enfant, et la haine que lui déclare Giulianna en le quittant, le poussent au suicide. Peu de temps après avoir visionné, avec ses proches collaborateurs, le film dans un premier montage dont il n'était pas satisfait, Visconti mourut (au printemps 1976), victime d'une forme grave de thrombose. Le film fut présenté au public dans cette version, mis à part quelques retouches apportées à la mise en scène par sa collaboratrice Suso Cecchi d'Amico qui se basait sur les indications laissées par le réalisateur au cours d'une discussion de travail. Visconti avait dit ne pas se retrouver dans ce film, et avoir « filmé non seulement la désagrégation d'une famille, mais aussi celle d'une certaine société »3. Jean-Louis Bory, critique de cinéma au Nouvel Observateur, n'y vit, à sa sortie en 1976, que le détournement d'un « mélodrame mondain qui lui devient prétexte pour peindre une société qui n'existe plus que par la représentation qu'elle se donne à elle-même »4. Rina Morelli, actrice que Visconti estimait beaucoup et avec laquelle il avait partagé les grandes saisons théâtrales de l'immédiat après-guerre, mourut peu de temps après lui. Un musée est consacré à Luchino Visconti à Ischia. Analyse Visconti par lui-même Le metteur en scène milanais « a consciemment rattaché ses propres films à ses souvenirs autobiographiques », nous dit René de Ceccaty, traducteur en français du Roman d'Angelo, œuvre littéraire inachevée de Luchino Visconti. Situations, scènes et personnages des films réalisés par Visconti constituent presque invariablement un florilège de réminiscences intimes et personnelles. Voici comment Visconti se décrit lui-même : « Je suis venu au monde le jour des Morts par une coïncidence qui restera toujours scandaleuse, en retard de vingt-quatre heures peut-être sur la fête de la Toussaint... Cette date m'est restée attachée pour la vie comme un mauvais signe. Je viens d'une famille riche. Mon père, bien qu'aristocrate, n'était ni stupide ni inculte. Nous étions sept enfants, mais la famille s'en est bien sortie. Mon père nous a élevés sévèrement, durement, en nous aidant à apprécier les choses qui comptaient : la musique, le théâtre, l'art... J'ai grandi dans une odeur de pharmacie : nous, les enfants, entrions dans les couloirs de l'établissement Erba, qui sentaient l'acide phénique, et c'était une telle excitation, une telle aventure ! Le sens du concret que je crois toujours avoir possédé me vient de ma mère... Elle aimait beaucoup la vie mondaine, les grands bals, les fêtes fastueuses, mais elle aimait aussi ses enfants, la musique, le théâtre. C'est elle qui s'occupait chaque jour de notre éducation, qui m'a fait apprendre le violoncelle. » (Settimo giorno, 28 mai 1963) Cette mère tant aimée, les critiques n'ont pas manqué d'en souligner la ressemblance avec la mère « proustienne » de Tadzio, l’éphèbe de Mort à Venise. « Il n'y a pas un instant de notre vie d'alors qui ne s'illumine dans le souvenir de la présence attentive de ma mère... Mon souvenir le plus heureux se situe à la première heure, avant le petit déjeuner... Je vois encore le reflet de la lumière incertaine sur mon violoncelle, je sens le poids léger de la main de ma mère sur mon épaule », nous confie encore Luchino Visconti. René de Ceccaty rappelle également que Visconti précisait que le Prélude, choral et fugue de César Franck, que joue la mère dans Sandra, incarnée par Marie Bell, était souvent interprété par sa propre mère. =========================================================
24 mars 2009
Luchino Visconti aura marqué le 7e Art d'un esthétisme flamboyant, contribuant ainsi à la stylisation de la réalité et à la mise en opéra de l'histoire.
De sa famille, l'une des plus nobles d'Italie, Luchino Visconti hérite d'un raffinement inouï, d'une vaste culture et de l'amour du théâtre. Le cinéma l'attire également et il décide de faire carrière dans la mise en scène. Son goût très sûr mais ses idées progressistes dans l'Italie fasciste de Mussolini l'incitent à se rendre en France, où il travaillera avec Jean Renoir dans "Une partie de campagne" en 1936. La guerre interrompt leur collaboration qui devait se poursuivre en Italie avec "Tosca" et figurait déjà l'attraction qu'il éprouvera toujours pour l'art lyrique et les récits raffinés.
Son oeuvre cinématographique s'inspire souvent d'éléments et de faits puisés dans un temps historique situé de préférence entre 1850 et 1950, qu'il déploie à la manière ample d'un opéra, parce que son intuition a très tôt fondé son art de telle sorte que la perfection atteigne sa somptueuse plénitude. C'est l'expression d'une exigence qui ne laissera au hasard aucun détail, aucune nuance, aucun des sentiments les plus subtils de l'âme humaine. "Ossessione" ( Les amants diaboliques ), en 1943, donne le coup d'envoi de ce que sera le néo-réalisme et se révèle être aussi sombre et pessimiste que certaines oeuvres de De Sica, à la différence que Visconti se refusera toujours au didactisme et à tout sentimentalisme démagogique.
Au lendemain de la guerre "La terre tremble" ( 1948 ), qui a le don d'exaspérer le monde de la finance, forme avec "Ossessione" et "Rocco et ses frères" une trilogie imprévue qui brosse un portrait social de l'Italie des pauvres, de ses violences et de ses migrations dans l'illusion, mais l'oeil que pose le réalisateur sur la civilisation et les hommes reste avant tout un regard poétique, au sens fort du terme. Dans la fable merveilleusement mélodramatique de "Bellissima" ( 1951 ), où Anna Magnani se révèle être plus que jamais telle qu'en elle-même, l'auteur ironise sur l'envers de l'illusion, sur le temps du rêve, mais veille à ne pas s'attendrir exagérément sur la crédulité populaire. Visconti sait ne retenir que ce qui est le plus significatif dans la narration et veille à l'épurer de toute complaisance, car seul lui importe ce qui suggère et dénonce. Le réalisateur sait trop que la réalité ne se charge de sens qu'en fonction de l'impact de l'écriture et de l'unité interne de l'oeuvre. Ainsi des intérieurs rustiques de "Rocco et ses frères" aux somptueuses natures mortes de "Senso" ou du "Guépard", il met une scrupuleuse attention, aussi bien historique que sociale et psychologique, aux gestes, aux objets, aux toilettes, afin de recréer dans sa globalité le milieu et le climat de l'époque et lui restituer son authenticité et sa vraisemblance, car la vérité de ces recréations en constitue le label, l'ombre de l'échec et celle de la mort s'étendant peu à peu sur la vie. C'est à cause de ce regard tout ensemble critique et poétique que le concept de nostalgie existe et établit un lien, qui coure sans se rompre jamais du premier au dernier de ses films, que ce soit "Le Guépard", "Sandra", "Mort à Venise", " Ludwig", "Violence et passion", Visconti contribuant ainsi à la stylisation de la réalité, à la mise en opéra de l'histoire. Il y a de sa part, et en contre-champ, un moralisme stendhalien que la fréquentation de l'histoire n'incline guère à l'optimisme et un goût identique, chez le metteur en scène de "Mort à Venise" et l'auteur de "La Chartreuse de Parme", pour les passions sans retenue. Chacun de ses sujets exalte un peu plus, un peu mieux son exceptionnel génie plastique, son esthétisme flamboyant qui évolueront des gris d"'Ossessione", des noirs et blancs de "La terre tremble", à l'impressionnisme raffiné de "Mort à Venise" ou au romantisme pictural de "Ludwig". Mais il arrive que le metteur en scène cède à la parodie et que le souci de vérité - ce sera le cas dans "Les damnés" - l'incite à peindre d'un pinceau acéré certains portraits de névropathes et qu'il mette ses pas dans ceux de Dante pour mieux nous plonger dans l'enfer des damnations humaines. Dans ces derniers opus "Violence et passion" ( 1974 ) et "L'innocent" ( 1976 ), l'inspiration s'embrume d'une douleur à peine voilée, s'infléchit dans une contemplation amère et pessimiste de l'art et de l'histoire qui rejoint la prémonition de la mort imminente, alors que le sublime amour, interdit, impossible, inavouable, fait peser sur les fragments de vie l'ombre opaque de son échec. Un combat avec le temps, et contre lui, investit l'oeuvre et nous la restitue en un oratorio pathétique, d'où ne sont exemptes ni la faiblesse, ni la grandeur.
Pour prendre connaissance des articles que j'ai consacrés à Romy Schneider et aux Réalisateurs, cliquer sur leurs titres :
Et pour consulter la liste complète des articles de la rubrique CINEMA EUROPEEN & MEDITERRANEEN, dont Mort à Venise, Senso, Ludwig et Le guépard, cliquer sur celui ci-dessous :
https://www.livres-cinema.info/biographie/luchino-visconti |
Biographies : Luchino Visconti (15 livres)
• Biographies (15 livres)
Editeur : Actes Sud
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Luchino Visconti (2002)
Vérités d'une légende
Editeur : Bibliothèque du Film - BIFI
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Luchino Visconti (1989)
Les feux de la passion
Editeur : Flammarion
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Luchino Visconti (1987)
Les feux de la passion
Editeur : Perrin
(ancienne édition)
(ancienne édition)
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Luchino Visconti, cinéaste (1983)
Editeur : Ramsay
(ancienne édition)
(ancienne édition)
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Collectif
Editeur : L'Avant-Scène Cinéma
> Autres livres ayant pour sujet Luchino Visconti:
Collectif dir. Denitza Bantcheva
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Théâtres au cinéma (2004)
Luchino Visconti, Gabriele D'Annunzio, Guiseppe Verdi
Collectif dir. Dominique Bax
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Luchino Visconti (1997)
Cannes 1963
de Gérard Pangon et Noël Herpe
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Visconti (1989)
Classicisme & subversion
Collectif dir. Michèle Lagny
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
Sujet : Réalisateur > Luchino Visconti
> Autres livres en relation avec Luchino Visconti :
Sujet : Un Film > Mort à Venise
Les Images du temps (1995)
dans Vaghe stelle dell'Orsa de Luchino Visconti
Destins d'étoiles, tome 1 (1991)
Sujet : Réalisateur
Nota : Un livre sur fond légèrement grisé est un livre qui n'est plus actuellement édité ou qui peut être difficile à trouver en librairie. Le prix mentionné est celui de l'ouvrage à sa sortie, le prix sur le marché de l'occasion peut être très différent.