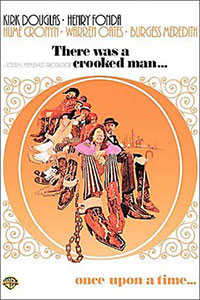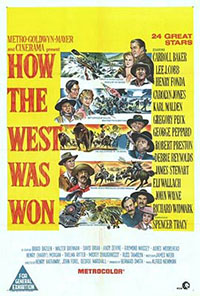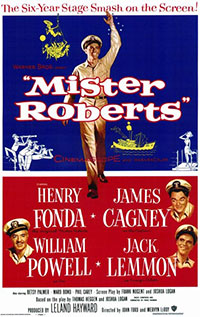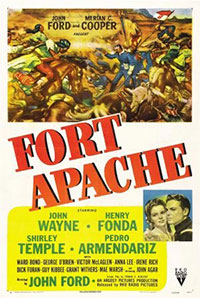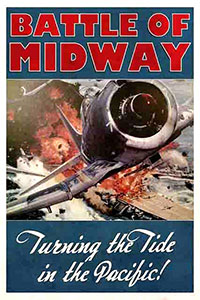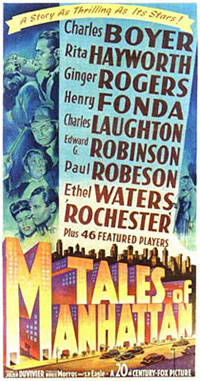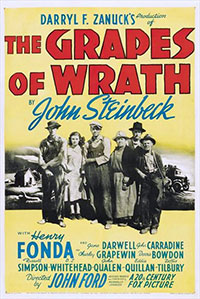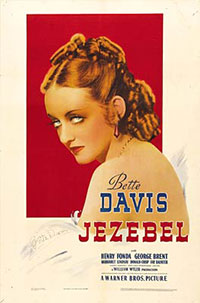PRESTON STURGES : LE RIRE ET LA DÉRISION
Aussi brillant metteur en scène que scénariste, Preston Sturges va renouveler la comédie américaine. Son humour s’exercera souvent aux dépens de l’« american way of life ».

De qui parle-t-on ? D’un Américain, d’un flambeur, d’un désinvolte. Du Mark Twain du septième art. Du traducteur de Marcel Pagnol. De l’inventeur de l’avion à décollage vertical. Du troisième salarié le mieux payé des Etats-Unis. D’un pochetron connu comme le loup blanc dans les bars du quartier des Champs-Elysées. Du propriétaire d’un restaurant sur Sunset Boulevard. De l’enfant de Mary qui donna l’écharpe fatale à Isadora Duncan. D’un célèbre inconnu. D’un dilettante de génie, digne de Stendhal et de Savinio. D’un fervent du mariage – à la façon d’un Sacha Guitry (qu’il admirait). Du scénariste le plus cultivé d’Hollywood qui affectait de mépriser le « culturel », D’un orgueilleux. Du premier véritable auteur d’un cinéma parlant américain. Oyez, oyez, bonnes gens, l’étrange et terrible histoire d’un homme qui voulut un jour laver un éléphant. [Preston Sturges ou le génie de l’Amérique – Marc Cerisuelo – PUF (10/2002)]

« Je n’ai d’autre ambition que celle de raconter une histoire », disait Preston Sturges. En considérant le scénariste comme un auteur à part entière, ce maître de la comédie américaine, à l’égal d’un Capra ou d’un Lubitsch, va révolutionner l’« establishment » hollywoodien. Estimant que l’on n’est jamais si bien servi que par soi-même, il passera derrière la caméra pour réaliser ses propres sujets.

Avec huit films tournés de 1940 à 1944, il fera ainsi une démonstration éblouissante de son talent, s’attaquant allègrement à tous les mythes américains, du culte de la réussite matérielle au respect des héros, et lançant sans cesse des défis à la censure et aux convenances. Après ce véritable feu d’artifice, sa veine semble se tarir et sa production se ralentit (peut-être aussi les producteurs hollywoodiens se méfient-ils, non sans raison, de ce diable d’homme). Toujours est-il qu’il ne rencontrera plus jamais le même succès. Toutefois son œuvre a toujours conservé un très grand prestige. Preston Sturges fait partie de ces cinéastes qui, tout en ralliant les suffrages du plus vaste public, parviennent à imposer une vision très personnelle et inimitable du monde et de la vie.

LES DÉBUTS
Preston Sturges, né en 1898, a grandi dans un milieu très anticonformiste. Il passe chaque année six mois à Paris avec sa mère, qui est une amie intime de la grande danseuse Isadora Duncan et qui veille de près à son éducation artistique et musicale. Les six autres mois, il les passe à Chicago, auprès de son beau-père, qui l’initie pour sa part au monde des affaires.

Cherchant sa vocation, Sturges dirige tout d’abord l’un des instituts de beauté de sa mère, où il met au point un rouge à lèvres à l’épreuve du baiser… Puis il cherche à gagner sa vie comme inventeur. Lors d’un séjour à l’hôpital, en 1927, l’idée lui vient d’écrire pour le théâtre. Ainsi naît « Strictly Dishonorable » ; deux ans plus tard, ce sera le succès à Broadway. En 1931, Hollywood adapte cette pièce à l’écran et c’est ainsi que son auteur se trouve engagé pour écrire les dialogues des premiers films parlants tournés à New York.

Sturges continue cependant à écrire des sujets originaux. Jesse Lasky, enthousiasmé, lui achète l’un d’eux, The Power and the Glory (Thomas Gardner, 1933), qui retrace, en une succession de flash-backs, l’ascension et la chute d’un magnat du chemin de fer (déjà le thème des caprices de la fortune). Il signe ensuite le scénario de deux comédies de Mitchell Leisen : Easy Living (Vie facile, 1937) et Remember the Night (1940).

UN SUJET POUR DIX DOLLARS
Mais Preston Sturges entrevoit très vite les limites de son rôle de scénariste. Seule la mise en scène lui permettrait de contrôler véritablement son œuvre. Pour décider la Paramount à lui confier la direction de The Great McGinty (Gouverneur malgré lui, 1940), il se contentera d’un petit budget et il cédera son sujet pour la somme dérisoire – et symbolique – de dix dollars ! Cette brillante satire de la corruption politique américaine (où Brian Donlevy campe un gouverneur sans scrupule, ramené dans le droit chemin par la femme de sa vie obtient un vif succès (et vaudra à Sturges un Oscar en 1941). Après des débuts aussi heureux, la Paramount confie aussitôt à Sturges la mise en scène de Christmas in July (Le Gros Lot, 1940) et de The Lady Eve (Un Cœur pris au piège, 1941).

A travers Sullivan’s Travels (Les Voyages de Sullivan, 1942), avec Joel McCrea et Veronica Lake, Sturges expose avec virtuosité ses propres conceptions du cinéma. Les mésaventures de ce cinéaste hollywoodien qui se mêle incognito aux clochards afin de donner un cachet d’authenticité à son prochain film (et qui se trouve pris au piège de cet univers différent) lui permettent de jouer brillamment sur les ruptures de ton. Le drame fait irruption dans la comédie et les ironies du destin modifient les ambitions du héros, qui découvre que le rire est la chose la plus nécessaire aux déshérités. Une œuvre étonnamment moderne, où le rire recouvre une profonde amertume.

Deux nominations aux Oscars vont consacrer le talent de scénariste de Sturges: pour The Miracle of Morgan’s Creek (Miracle au village, 1943) et pour Hail the Conquering Hero (Héros d’occasion, 1944), qui ont tous deux pour vedette Eddie Bracken. Au mépris du Code Hays, The Miracle of Morgan’s Creek met en scène une jeune fille mettant au monde des quintuplés à la suite d’un mariage inopiné (et sans valeur légale) contracté au terme d’une folle nuit de fête. Après bien des quiproquos, l’idiot du village se verra attribuer cette quintuple paternité qui lui gagnera enfin la considération de ses concitoyens. Le film aura d’ailleurs des démêlés avec la censure et sa sortie sera retardée. Dans Hail the Conquering Hero, Eddie Bracken, réformé pour cause de rhume des foins, se fera passer aux yeux de sa mère, au prix d’incroyables stratagèmes, pour un héros, afin de satisfaire aux traditions patriotiques familiales.

Réalisé en 1943 – mais distribué seulement en 1944 – The Great Moment retrace la vie du dentiste américain William Morton, qui expérimenta au XIXe siècle les premiers anesthésiques. Un sujet édifiant que Sturges agrémente de gags burlesques. Tout comme dans The Great McGinty , il dément cyniquement l’adage moral qui veut que la vertu soit récompensée. En renonçant noblement aux profits de sa découverte pour soulager son prochain, le héros signe sa propre ruine. Ce sera aussi le premier échec commercial de Sturges…

STURGES L’ICONOCLASTE
Dans The Palm Beach Story (Madame et ses flirts, 1941), l’héroïne Claudette Colbert est adoptée comme mascotte par un groupe de millionnaires excentriques : le « Ale and Quail Clubé. Parmi ceux-ci on retrouve bon nombre des remarquables acteurs de second plan qui contribuent, tout autant que les vedettes, à créer l’univers typique de Sturges. Citons notamment William Demarest, qui marque de sa présence tous les films de cette période, ou encore Robert Creig, Franklin Pangborn, Jimmy Conlin, Dewey Robinson, Torben Meyer, Harry Hayden et Esther Howard.

Les films des années 1940-1944 associent avec bonheur – mais non sans déconcerter parfois le public – un ton très sophistiqué et des gags effrénés, dans le plus pur style « slapstick ». Avec une audace inouïe, Sturges dynamite allègrement les valeurs américaines les plus établies. Aucun mythe, aucun tabou n’échappe à son humour corrosif. Pas même le culte du héros ou le respect de la réussite matérielle. En 1944, alors que l’Amérique exalte l’effort de guerre, il tourne en dérision l’armée et les vertus civiques des citoyens disciplinés. Dans la plupart de ses comédies, il déboulonne de son piédestal la femme américaine et sa verve caustique n’épargne ni Hollywood ni le monde politique. Ses personnages sont souvent des ingénus inadaptés, sur lesquels s’accumulent les coups du sort – et la réussite intervient toujours au moment où ils l’ont le moins méritée… Mais, tout comme ses héros, Sturges ne va pas tarder à être victime des caprices de la fortune.

ECHECS ET DÉCEPTIONS
S’étant finalement attiré la méfiance des producteurs, Sturges abandonne la Paramount en 1944 pour travailler avec Howard Hughes. Mais cette collaboration s’annonce sous de mauvais auspices. The Sin of Harold Diddlebock (Oh ! Quel mercredi, 1946), qui marque le retour sur les écrans de Harold Lloyd, sera tout d’abord interrompu faute de pellicule (suite aux restrictions de l’après-guerre).

Puis son exploitation est compromise par un caprice de Hughes, qui retire le film du circuit pour en modifier le montage ; Il ne le remettra en distribution qu’en 1950 sous le titre de Mad Wednesday. Ce qui n’empêchera pas le public de bouder les exploits extravagants de Harold Lloyd, paisible employé se lançant dans des dépenses somptuaires lorsqu’il perd sa place après vingt ans de loyaux services,

En 1948, Sturges quitte donc Hughes pour la Fox, qui lui offre un contrat intéressant. Il réalise alors Unfaithfully Yours (Infidèlement vôtre, 1948), étincelante comédie où l’on voit le chef d’orchestre, Rex Harrison, passer mentalement en revue pendant qu’il dirige un concert les différentes alternatives qui se présentent à lui face à l’infidélité présumée de sa jeune épouse Linda Darnell. Le film est un échec commercial retentissant.

C’est par un autre échec que se termine la carrière hollywoodienne de Preston Sturges, avec The Beautiful blonde from bashful bend (Mam’zelle Mitraillette, 1949). Le public accueille en effet froidement cet étonnant western parodique, malgré la présence de Betty Grable. Il semble d’ailleurs que Sturges, pourtant habile directeur d’acteurs, n’ait pas su ici mettre en valeur son sens du rythme et ses dialogues sont moins percutants qu’à l’ordinaire.

Déçu par Hollywood, le metteur en scène se consacre désormais au théâtre. En 1953, il quitte même l’Amérique pour s’établir en France, où il dirigera son dernier film, Les Carnets du major Thompson (1955). Une entreprise qui n’ajoutera rien à sa gloire ! De retour à New York, il obtient d’un éditeur une substantielle avance pour rédiger ses mémoires, qu’il intitule : « Les événements qui m’ont conduit à la mort » ! Il ne croyait pas si bien dire puisqu’il disparut le 6 août 1959, alors qu’il n’avait écrit que la moitié de son manuscrit.

Auteur souvent méconnu, Preston Sturges reste l’un des grands noms du cinéma. Un cinéma qu’il aimait passionnément, au point de rendre souvent hommage, dans ses œuvres, à ses plus grands réalisateurs. En 1975, William Wyler écrira : « Je suis incapable de faire un bon film si je n’ai pas scénariste à la hauteur. Preston Sturges n’avait pas ce problème, var il avait le meilleur à sa disposition : lui-même ! Ainsi il était l’auteur intégral de ses œuvres. »